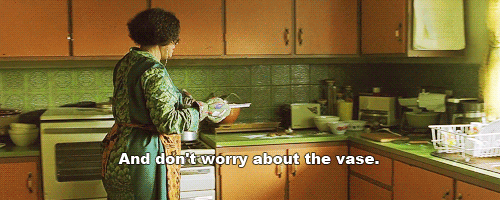Intension semble être à la fois hors
du temps et hors de l'album, prise dans une parenthèse musicale et
temporelle. Suspendue au milieu des autres chansons elle nous
transporte ailleurs, dès les premières secondes. Elle ne tranche
pas avec le reste, comme le fait The Pot, qui est un titre
frénétique, ironique et incisif, qui est un titre virulent.
Intension met à distance. Elle met à distance le reste de l'album,
finissant de le disloquer après la première parenthèse que
constitue le tryptique Lipan Conjuring, Lost Keys et Rosetta Stoned.
Elle met à distance l'auditeur, l'arrachant du sol. Pendant plus
d'une minute, il n'est presque pas question de musique. Raclements
métalliques, sons diffusés à l'envers dans une sorte d’apesanteur,
propos diffusés à l'envers qui résonnent comme les paroles d'un
rituel magique, percussion ronde comme une bulle d'air qui remonte à
la surface puis le chant, calme, posé, presque traînant, comme une
prière ou une lamentation. On est plus proche, dans cette ambiance,
avec le son des tambourins, l'effet sur la voix qui transforme le
chant d'un seul en chant collectif, du côté du rituel musical,
rituel de conjuration, que de la chanson métal. Comme si on
décollait, emportés loin d'un monde où la violence rampe au sol.
Afin de la contempler et de la resituer dans un contexte plus vaste.
Afin de lui redonner sa juste échelle. Et il est bien question de
hauteur dans cette chanson, ainsi que dans la suivante, de hauteur de
vue, du jugement supérieur, de vision synoptique que seule apporte
prise de distance métaphysique.
Intension, c'est l'expérience d'une
sortie hors du corps, musicalement assistée.
C'est à partir de cette chanson que la
structure de l'album se dévoile pour de bon. Intension est à la
fois un choc esthétique et une révélation.
Cet album est un chemin de croix, une
volonté répétée de guérir l'homme de sa haine, qui échoue
toujours mais se renouvelle à chaque fois. La haine exprimée dans
Vicarious est d'abord exorcisée par l'expérience du deuil et de la
mort ; vivant personnellement ce traumatisme, on est moins tenté
de s'en réjouir quand il arrive aux autres. Mais après l'espoir
qu'offrent Jambi et Wings For Mary, The Pot vient tout ruiner. Cette
chanson, contre l'hypocrisie des discours religieux, radicalise des
éléments déjà présents dans Wings for Mary, mais se détourne
entièrement de l'expérience de la douleur, ignore la manière dont
elle nous transfigure et nous élève, pour n'en tirer qu'un nouveau
motif de haine et de moquerie.
Lipan Conjuring vient rabattre les
cartes, mais l'espoir d'obtenir une vision cosmique des choses par
les drogues mène rapidement à une impasse (rosetta stoned). Le
groupe a toujours eu, dans les paroles de ses chansons, un regard
critique là-dessus. Lipan Conjuring, ce pur rituel, lost keys et
Rosetta Stoned est un second cycle, sans progression, qui saute et
balbutie, et un second échec.
Intension semble reprendre Lipan
Conjuring, mais plutôt que de simplement reprendre le rituel tel
quel, comme un élément culturellement étranger, la chanson
l'assimile, l'intègre musicalement et rationnellement. Ce n'est plus
un rituel indien, c'est un rituel musical, avec des paroles
concertées qui en reproduisent l'effet tout en en maîtrisant les
moyens. Il ne mène pas dans un rechute violente dans le corps, comme
Rosetta Stoned, qui en revient toujours au détail scato pour évoquer
la redescente (« goddamn, shit the pants »), mais ouvre à
une compréhension plus large du monde : Right In Two, où l'on
s'élève au niveau des anges.
L'album là dessus s'achève sur une
conclusion mystérieuse, tant dans son titre que dans son contenu,
conclusion qui nous laisse démuni, incapable de savoir s'il s'agit
d'un nouvel échec (23 est le signe de la discorde érigée en
divinité dans un livre mystique parodique, Principia discordia) ou à
une victoire définitive sur la haine (le 23 peut renvoyer à
l'arcane 23 du tarot de Thot, qui renvoie à l'acquisition de
connaissance et à l'élévation spirituelle par l'effort et le
travail) ou n'est finalement qu'une simple manière humoristique
d'achever le cd, en laissant tout en suspens (23 skidoo est une
manière argotique de dire qu'on part en vitesse).
Autre élément ambivalent, les paroles
passées à l'envers. Elles se moquent évidemment de ceux qui
croient que des messages de haine sont diffusés à l'envers dans les
disques de rocks, invitant à vénérer Satan ou à se suicider.
Elles sont positives au possible, presque naïves : « écoute
ta mère, ton père à raison, vas à l'école, ne prend pas de
drogues ». Elles se moque aussi des fans du groupe qui
surinterprètent tout et se persuadent à la fin que les chansons
regorgent de messages cachés, mais elles servent surtout peut-être
de solution métaphorique au problème de la haine.
Diffuser un message à l'envers, c'est
l'orienter vers le passé, c'est remonter le temps afin de changer
les anciens événements et les attitudes préjudiciables. Une sorte
de retour vers le futur ; de la même manière que Marty est
transformé par les voyages et les messages temporels, devient un
jeune homme responsable et pas cette tête brûlée incapable de se
contenir qu'il était au départ, nous devrions pouvoir être
transformés rétroactivement par l'écoute de ces paroles
conciliatrices. En corrigeant des attitudes de séparation, en
invitant tôt à l'union et à la concorde, à l'écoute de l'autre,
peut-être y a-t-il possibilité de prévenir les grandes fractures
qui divisent la société. Or c'est justement ça que se propose de
faire Intension : remonter aux premières causes des fractures
sociales, des oppositions entre les hommes aujourd'hui devenues
insurmontables et voir s'il était possible de les corriger, voir si
une autre histoire pour l'homme aurait été possible. Il ne faut
donc pas se laisser à dire, comme beaucoup, que cette chanson
retrace l'histoire de l'humanité. C'est une ânerie. Il n'y est
question que de quelques moments critiques pendant lesquels tout
encore est possible, non pas d'une histoire continue mais de deux
moments qui ont décidé de toute la suite de l'histoire. Le titre,
Intension, est à la fois intention, expression d'une volonté, et In
Tension, en tension, dans le sens d'être tiraillé entre deux choix,
deux directions, sans pouvoir décider, mais sans pouvoir s'abstenir
de choisir. Il traduit l'état de stress que l'on subit quand on doit
décider en toute urgence entre deux options toutes deux
catastrophiques.
Ainsi, dans les paroles, l'homme
balance toujours entre amour et haine, accueil et rejet. Le stress
vient du fait que l'on ne peut choisir l'un sans tomber dans
l'autre : si je construit un foyer, je le fais par amour, mais
je dois le protéger, et donc développer des sentiments négatifs,
méfiance ou haine, envers l'étranger qui menace l'unité et la paix
du foyer. De même, cet amour devient la justification des haines que
l'on peut éprouver et une raison confortable de les laisser éclater.
La chanson semble dire que cette situation est due entièrement à
nos innovations technologiques et non à une nature particulièrement
belliqueuse. Il ne faut pas se laisser abuser par l'omniprésence de
la volonté (will) dans les paroles ; ce n'est pas une intention
continue, une volonté libre de tuer qui s'exprime ici, mais une
volonté contrainte. La chanson dit bien « moved by will
alone », mis en mouvement et non pas « ruled »,
réglé, dirigé par la volonté. La volonté libre, l'intention pure
a donné la pichenette au départ, a mis en mouvement l'humanité au
tout début, mais la volonté ne dirige plus l'homme, l'habitude
maintenant agit en nous collectivement. Nous sommes prisonniers d'un
choix passé qui agit en nous et contre lequel nous ne pouvons rien.
Prisonniers d'un inconscient que la chanson met au jour. Le contenu
de la chanson ne nous concerne pas directement, le choix mis en scène
n'est pas le nôtre, mais nous devons comprendre que nous sommes
embarqués dans le destin technologique, que nous sommes condamnés
par lui à la violence dès lors que l'on veut agir et user de ces
technologies. Nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons plus corriger
cela. D'où les échecs précédents et la fuite hors du temps et de
l'espace que nous propose maintenant le groupe comme issue finale.
23 skidoo, voilà la solution :
une fuite hors du monde qui nous arrache au chaos, mais qui exige
pour cela que nous abandonnions tout espoir d'agir contre ce qui
arrive, de combattre la haine. C'est une contemplation pure qui nous
est offerte comme solution. Ici bien sûr je pourrai évoquer
Schopenhauer, qui considère que tout le malheur du monde vient de
l'expression de la volonté et du désir et que le bonheur réside
dans la sainteté et dans la contemplation artistique qui met le soi,
le désir, la volonté, entre parenthèse. En ce sens, écouter 10
000 est faire œuvre de paix. Mais cette chanson n'est pas la
traduction d'une philosophie—et je voulais finir là-dessus, elle
est la transcription d'un tableau. J'ai parlé d'expérience hors du
corps, il faudrait plus exactement parler d'extase. L'extase est bien
une sortie hors de soi, mais vers une vérité qui frappe par son
évidence et sa simplicité et vers une bonté sans limite qui nous
submerge. Or il est remarquable que la chanson qui suit Intension se
place du point de vue des anges, véhicules de la vérité et de la
bonté divine. Intension est ce pont entre le chaos, le mal, l'abysse
et la plénitude divine. Entre les deux, donc, une chanson tiraillée
entre les deux directions, entre le haut et le bas, un juste milieu
fragile autant qu'un passage de l'un à l'autre, juste milieu et et
passage entièrement concentré dans la voix merveilleuse d'un
Maynard transfiguré en Sainte Cécile, sainte patronne des
musiciens, à moins que ce ne soit en Raphaël.
Dans ce tableau, L'extase de Sainte
Cécile, nous voyons tout en bas de l'image, au premier plan, des
instruments usés, un triangle, un lirone, un tambour crevé. La
sainte elle-même cesse de jouer, les tuyaux de son orgue tombent
tandis qu'elle élève le regard. On croirait voir les sons de cette
introduction, cymbales et triangles qui tombent, pluie d'instruments,
non violemment et bruyamment comme dans disgustipated, la dernière
chanson de Undertow, non avec haine, mais comme s'ils s'abandonnaient
eux-mêmes. Ils se désintègrent. Et de cette musique qui tombe,
seule la voix au dessus des orgues s'efforce de s'élever, les
intonations finales s'envolant comme des questions. En haut, les
anges chantent, leur musique se passe d'instrument et Sainte Cécile,
les écoutant, est illuminée et sereine. L'orgue dans ses mains,
instrument de la musique sacrée par excellence, montre qu'elle
jouait afin d'emporter l'âme dans un état de contemplation, dans un
état « d'extase musicale », et non seulement pour faire
plaisir. Il est vrai que la musique est l'art le plus insidieux en
cela qu'il pénètre en nous qu'on le veuille ou non, qu'il nous
émeut malgré nous et modifie notre état bien plus directement et
facilement que n'importe quel autre art. Il peut nous faire croire à
Dieu malgré nous. Son orgue est le pendant des rythmes tribaux
exploités par Tool, ils en ont le même but, le même effet :
emporter notre âme dans la contemplation de vérités qui nous
dépassent et qui ne peuvent pas s'exprimer adéquatement à travers
des instruments. Cette musique qui s'entend au delà de la musique,
Raphaël la restitue par un chœur d'anges chantant. D'où la sortie
hors de la chanson, dans un au-delà, donc, où les anges eux-mêmes
chantent.
Daniel Arasse affirme que Raphaël a traduit dans ce tableau la
« conception néo-platonicienne de la triple nature de la
musique ». Au premier plan, la musica instrumentalis, au
centre, la musica humana, musique de l'âme, enfin, la musica
mundana, la musique cosmique. Citant Chastel, il affirme que la
musique est ici « reliée à tous les étages de l'être,
qu'elle touche à la fois la basse conscience, liée à la nature
physique, la conscience éclairée qui jouit de la beauté du nombre
[j'imagine, les harmonies et les accords, qui sont des rapports
mathématiques] et la conscience supérieure qui saisit un univers
transfiguré ».
Dans le tableau, les instruments usés
et rendus inutilisables montrent l'impuissance de ces instruments,
qui flattent les sens, à jouer la musique céleste, à élever l'âme
à la vérité. Cela parce qu'ils appartiennent au règne chaotique
de la basse matérialité et sont vouée à la destruction. Tout le
contraire d'une spiritualité intemporelle à laquelle nous accédons
dans la vision béate.
C'est ce monde-là que fuit Tool à
partir de cette chanson, abandonnant les destins particuliers des
titres précédents qui gisent maintenant au sol, pour s'élever au
niveau de l'humanité entière, pour proposer une musica humana, un
chant de l'humanité qui prépare l'âme à de nouvelles révélations
mais qui doit quand même passer par la médiation d'instruments,
d'instruments plus dignes certes, de rythmes et d'harmonies plus
pures, images d'une nature centrale et ordonnée, mélange de corps
et d'esprits, mais qui ne pourra jamais égaler la musique purement
sacrée, immatérielle, des anges (qui dans leur multiplicité sont
les prototypes parfaits de tout ce qui se réalisera dans la nature).
Ces anges se passent d'instrument, images d'une vérité qui frappe
directement l'âme, chant intérieur qui illumine et béatifie et
qui, sans doute, ne peut s'entendre que dans l'intimité d'une écoute
solitaire ; ces anges qui chantent en lisant ressemblent à des
fans de Tool qui se laissent imprégner des paroles pour en
recueillir le sens, un sens qui nous frappe comme une révélation
soudaine et que l'on peine à retranscrire avec des mots, qui dans
leur matérialité ne peuvent que trahir la pensée qu'ils
s'efforcent d'exprimer. Cette musique de conversion et d'accord
profond avec le monde ne peut résonner qu'en nous et vient nous
saisir en un éclair quand nous écoutons avec intelligence et
sensibilité la musique qui flatte nos sens et les paroles qui
émeuvent notre âme. Quand, en un mot, on se laisse pénétrer
entièrement par ce qu'on écoute.